
Le presidium lors de cérémonie d'ouverture de la formation des journalistes à Dakar
En 2022, des centaines de millions d’africains n’ont toujours pas accès à une quantité suffisante d’eau salubre et à un assainissement adéquat. Pourtant, leurs Etats s’étaient engagés en septembre 2015, à New York, à permettre à chaque citoyen de jouir pleinement de ces droits fondamentaux à l’horizon 2030. Pendant que l’échéance arrive au galop, une jauge des politiques publiques en la matière ne rassure pas. Les experts sont sceptiques et les populations cibles totalement incrédules.
« Aujourd’hui, nous sommes loin de pouvoir garantir l’accès de tous et toutes à des services d’alimentation en eau et d’assainissement d’ici à 2030, comme le prévoit l’objectif de développement durable n°6. Certes, nous y tendons, mais les progrès actuels doivent être quadruplés pour que l’accès à l’eau soit universel. Le sous-investissement systématique dont souffrent les services d’alimentation en eau et d’assainissement porte préjudice à un nombre incalculable de personnes. C’est inacceptable ». Ces propos du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars 2021 est toujours d’actualité, notamment en Afrique.
Après le fiasco des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de 2000, qui hissait l’accès à l’eau potable et à l’assainissement au rang de priorité absolue de la communauté internationale, la majorité écrasante des Etats africains sont en bonne voie pour rééditer un autre revers. En effet, à travers la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, les Etats africains s’étaient engagés à réduire de moitié la proportion de personnes sans accès à l’eau potable et à l’assainissement d’ici 2015. A cette échéance, les résultats escomptés n’ont pas été réalisés. Les chefs d’Etat du monde, dont ceux de l’Afrique renouvellent l’engagement avec les Objectifs du Développement Durable (ODD) de 2015 qui comporte 17 objectifs. Le sixième engagement vise à « garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable ».
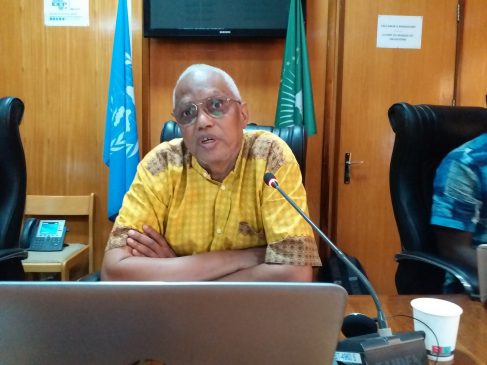
Un droit humain fondamental en souffrance sur le continent
A l’occasion d’une formation de journalistes africains tenue du 14 au 19 août 2022 dans la capitale sénégalaise, M. Moez Allaoui, directeur central de SONEDE (Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux de la Tunisie) a dépeint -chiffre à l’appui- une situation désolante sur le continent africain. Il a signalé que « 411 millions de personnes en Afrique n’avaient toujours pas accès au service de base d’eau de boisson en 2020 ». Sur ces 411 personnes, 58 millions se trouvent en Ethiopie, 48 millions en République démocratique du Congo, 46 millions au Nigéria, 23 millions en Tanzanie, 21 millions au Kenya et les 214 dans le reste de la région africaine. Ces chiffres corroborés par ceux récents de l’Unicef connaissent une légère hausse. Ainsi, selon l’Unicef qui a publié un communiqué à l’occasion du 9ème Forum Mondial de l’Eau de Dakar (du 21 au 26 mars 2022), « 418 millions de personnes » en Afrique ne bénéficient toujours d’un service d’eau potable de base. Pour ce qui est de l’assainissement, l’organisation onusienne indique que « 779 millions » manquent de services d’assainissement de base (dont 208 millions qui pratiquent encore la défécation à l’air libre) et 839 millions manquent de services d’hygiène de base. On peut également étayer ces données avec celles indiquées par le docteur Boubacar Barry, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’eau qui a fait des présentations lors de la formation de journalistes africains organisée par Africa 21 du 14 au 19 août 2022 à Dakar. L’homme est un docte dans le secteur avec plus de 40 ans d’expérience au cours desquels il a sillonné pratiquement toute l’Afrique. Il a révélé que sur le continent, « moins de 10% de la population des grandes villes possède des toilettes raccordées aux égouts » ; « seulement 10 à 30% des déchets ménagers sont éliminés ». Et « 90% des catastrophes naturelles sont liées à l’eau notamment les inondations ». Malheureusement, ces inondations et le manque d’eau provoquent plusieurs conséquences néfastes notamment de santé publique.
Une violation qui engendre des conséquences tous azimuts
C’est un secret de polichinelle. L’effectivité du droit à l’eau potable et à l’assainissement conditionne la réalisation d’autres droits fondamentaux comme le droit à la santé. Ainsi, selon l’ONG Water Aid, le manque de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène est responsable de « 10 % de la charge de morbidité mondiale », et contribue ainsi « chaque année à 1,6 million de décès évitables, dont 60 % sont dus aux maladies diarrhéiques », (Rapport 2021 Water Aid « Mission critique : Investir dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour une reprise économique saine et respectueuse de l’environnement ». Le choléra touche au moins 1,3 million de personnes chaque année, là où les services d’eau et d’assainissement sont perturbés ou inaccessibles. Selon les Nations Unies, « 2,3 milliards de personnes contractent chaque année des maladies d’origine hydrique » et ce sont les pays à faible revenu dont africains qui paient le plus lourd tribut. (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 15 (2002)). Il s’agit notamment, « du paludisme, de la diarrhée, le trachome, schistosomiase ». D’ailleurs, les Lignes sur le droit à l’eau en Afrique attachent plusieurs autres droits fondamentaux au droit à l’eau et l’assainissement. Il s’agit du droit à la vie, à la dignité, à l’éducation, le droit à un environnement satisfaisant, etc. En effet, ces lignes martèlent que « l’accès à l’eau potable et à l’eau nécessaire pour se nettoyer et se laver les mains est essentiel pour réaliser le droit à la santé ». Le docteur Boubacar Barry estime que le Covid 19 est venu démontrer à souhait cette assertion. Sur le plan alimentaire, ces Lignes directrices indiquent que « le droit à l’alimentation complète le droit à l’eau, avec la fourniture d’eau pour l’agriculture, la pêche et l’élevage, et la garantie d’autres moyens de subsistance liés à l’eau ».

L’un des majeurs problèmes de cadre de vie en Afrique est la défécation dans la nature ou l’air libre. Ce qui entraine de lourdes conséquences. Selon M. Célestin Pouya, directeur du département Plaidoyer et communication de WaterAid/Burkina, dans un gramme d’excrément humain on peut trouver dix millions de virus, un million de kystes, 100 œufs de vers. « Imaginez tous ces excréments qu’on retrouve dehors. C’est tout cela qui revient dans nos assiettes, nos sauces, viandes grillées et que nous consommons et qui cause des problèmes de santé publique », souligne-t-il. Dans la foulée, le directeur évoque une étude de l’OMS révélant que 70% des lits d’hôpitaux sont occupés par des personnes qui n’ont pas un meilleur accès à l’assainissement. M. Pouya révèle même en citant une étude de la Banque mondiale que le Burkina perd chaque une centaine de milliards du fait du manque d’assainissement.
Ces chiffres alarmants ne sont pas l’effet du hasard. Plusieurs facteurs concourent à la violation du droit d’accès à l’eau et à l’assainissement prévu par d’importants instruments juridiques de droits de l’homme édictés à l’échelle internationale, régionale et nationale (comme les Constitutions) évoqués par M. Moez Allaoui.
La faiblesse des politiques publiques
Moez Allaoui a défini le droit à l’eau comme le droit : « à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun ». Il précise que l’effectivité de ce droit qui échoit à chaque Etat africain est assise sur trois principes cumulativement dépendants. Il s’agit d’abord de « respecter » ce droit. Ce qui signifie que les Etats doivent s’abstenir d’obstruer « directement ou indirectement » la jouissance de ce droit. Ensuite, le principe de « protéger » qui implique que les États « doivent empêcher des tiers d’entraver l’exercice du droit à l’eau ». Enfin, le principe de « mettre en œuvre ». Ici, les gouvernements « doivent prendre des mesures législatives, administratives, budgétaires et autres pour assurer la pleine réalisation du droit à l’eau ». M. Allaoui précise que la mise en œuvre doit également se faire sans discontinuer et sans discrimination aucune. Pourtant les actions des Etats africains laissent à désirer. Pour le docteur Boubacar Barry, les animateurs des Etats africains sont caractérisés par un manque de volonté. Cela se vérifie par la faiblesse de la part des budgets qu’ils allouent à l’accès à l’eau et à l’assainissement. Par exemple, M. Armand Houanye, secrétaire exécutif du GWP-AO qui est intervenu sur la question de financement du secteur de l’eau, lors de la formation des journalistes, affirme que le « déficit des investissements dans l’eau est encore plus important pour atteindre la Vision africaine de l’eau 2025 ». Le secrétaire exécutif précise que seulement 10 à 19 milliards de dollar par an sont investis dans la sécurité de l’eau. Alors qu’un investissement de « 64 milliards de dollar par an est nécessaire» pour atteindre cette Vision.
Par ailleurs, le continent africain fait face à d’importants défis en lien avec ses ressources en eau douce. Elles font l’objet d’une baisse drastique à cause des impacts de la crise climatique mondialisée. Cette révélation a été faite -aux homme de médias participant à la formation de Africa 21- par le Dr Aïda Diongue-Niang du GIEC, pour qui les effets de cette crise sur les ressources en eau en Afrique sont « déjà très visibles ». Au regard de la gravité de la situation, l’experte en changement climatique martèle qu’« il faut pour l’Afrique des mesures transformationnelles ; et pour se faire, tous les éléments de la société doivent être impliqués. (…) Des réponses politiques doivent être apportées, basées sur la science et les savoirs endogènes ». La pollution grandissante des ressources en eau est une autre grosse préoccupation évoquée est par docteur Boubacar Barry. Le docteur attire l’attention sur ce phénomène qui risque d’annihiler toute politique publique en vue de garantir l’accès à l’eau. Sa préoccupation se fonde également sur cette démographie galopante en cours sur le continent pendant les politiques publiques en matière d’accès à l’eau ne rassurent pas. M. Cheik Mbacké Mboup, entrepreneur agricole et Président de la Coopérative des producteurs de fruits, légumes et d’élevage (COO.PRO.F.E.L) de Keur Mbir Ndao du Sénégal, venu présenter les activités de sa structure aux participants, s’est montré indigné sur ce qu’on pourrait qualifier de « gâchis hydrique ». En fait, pendant que les agriculteurs souffrent du manque d’eau dans leurs zones, la station de traitement des eaux usées de Dakar déverse d’importante quantité d’eau traitée dans la mer.

A la question de savoir si les pays africains réaliseront le point six des ODD en 2030, l’Unicef répond sans ambages dans un rapport : « Si les tendances de progrès actuelles se poursuivent, très peu d’États membres de l’Union africaine pourraient parvenir à un accès universel à une eau potable et à un assainissement gérés en toute sécurité ou à des services d’hygiène de base d’ici 2030 », « L’Afrique doit accélérer considérablement les progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène – rapport ». Les experts comme le Boubacar Barry, le docteur Anne Bousquet du Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA) sont également de cet avis. Par contre elle estime que l’Afrique du sud et le Maroc sont sur la bonne voie.
Aux fins de renverser la tendance, l’Unicef signale que l’atteinte des cibles des ODD en Afrique nécessitera une « multiplication par 12 des taux de progrès actuels en matière d’eau potable gérée en toute sécurité, une multiplication par 20 pour l’assainissement géré en toute sécurité et une multiplication par 42 des services d’hygiène de base ».
Hamidou TRAORE




