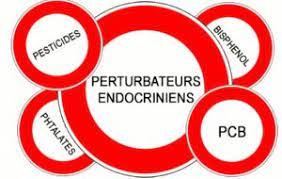Un maraîcher cultivant de la salade dans le lit du barrage de Boulmiougou, en plein Ouagadougou
L’épandage généralisé et incontrôlé des pesticides contamine gravement les maigres ressources en eau du Burkina qui, déjà se raréfient sous l’effet conjugué de la crise climatique et d’une pression croissante. Une situation qui expose les générations actuelle et future à une calamité hydrique avec de graves problèmes de santé publique et, à d’énormes pertes économiques. Même la biodiversité n’est pas épargnée par ce péril. Une eau continuellement empoisonnée face à une explosion démographique. Le danger n’est plus imminent. Il est déjà là !
Le Burkina Faso est désavantagé en matière d’eau à cause de sa position géographique. Des spécialistes comparent cette position à celle d’une « cuvette de soupe renversée ». Ce qui signifie que la grande partie de l’eau que le Burkina reçoit s’écoule vers les autres pays. Selon Pascal Nakohoun, directeur des études et information sur l’eau, « notre pays reçoit environ 200 milliards de m3 d’eau sous forme de pluie, mais nous ne retenons même pas plus de 10 milliards. ». En plus, d’autres facteurs aggravent la rareté du liquide précieux au Burkina Faso. Il s’agit notamment de la réduction de la pluviosité induite par le changement climatique, l’évaporation, l’évapotranspiration, les infiltrations et la sédimentation.
Mais le plus grand drame semble être le comportement néfaste de nombres d’usagers à travers la pollution des cours d’eau par l’usage explosif des pesticides : « Si nous polluons le peu d’eau que nous avons et que nous ne pouvons pas l’utiliser pour notre développement, nous condamnons pour le futur » ajoute M Nakohoun. L’usage des pesticides au Burkina Faso frise l’addiction et nuisent dangereusement par ricochet aux ressources en eau du Burkina. Moustapha Congo, Secrétaire permanent de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/GIRE) sur un ton de dépit observe que « L’ampleur de la dégradation des ressources en eau par les pesticides est proportionnelle à l’ampleur de l’usage de ces pesticides. Comme vous le savez aujourd’hui, les agriculteurs utilisent à grande échelle ces produits. Dans les champs, aux abords des cours d’eau, il y a une utilisation intense de pesticides. Même devant les concessions, les gens ne se donnent plus la peine d’utiliser la daba pour nettoyer leurs cours. Ils attendent que l’herbe pousse et ils utilisent les herbicides. Vous voyez jusqu’où va le phénomène ? Donc le risque de pollution de l’eau est élevé soit par le ruissellement qui conduit à la pollution des eaux de surface ou par l’infiltration qui présente un risque de pollution de la nappe phréatique. »
Même en pleine capitale les barrages sont contaminés

En mars 2021, de passage sur une voie serpentant le barrage N° 2 de la ville de Ouagadougou, nous apercevons des personnes qui, à la faveur de la saison sèche, pratiquer le maraichage dans le lit du barrage. Nous décidons d’aller vers elles. Elles sont visiblement heureuses de nous présenter des salades d’une verdure éclatante. Dans la foulée, ils reconnaissent que ce sont les « produits » pour faire allusion aux pesticides, entre autres, qui permettent aux plants de bien se développer… Nous leur désignons du doigt les installations de l’ONEA qui desservent Ouagadougou, la capitale en eau potable et leur demandons si ça ne pose pas problème. L’un d’eux se fonde sur la distance de ces installations (environ 1 km) pour conclure que l’usage des pesticides n’a rien de grave… Jusqu’à présent des citadins pratiquent de la maraicher-culture dans le barrage avec usage de pesticide. La situation au niveau du barrage de Boulmiougou, situé à l’arrondissement n°06, de Ouagadougou semble pire. Profitant de l’ensablement de cette retenue d’eau, des maraîchers utilisent une bonne portion pour produire des légumes avec l’usage de pesticides.
Le barrage de Noumbila qui assure près de 30% de l’eau potable à la ville de Ouagadougou est également en proie aux pesticides. En effet, le docteur Edouard Lehmann démontre à souhait l’envergure de la pollution de ce barrage par des pesticides et les conséquences que cela implique dans sa thèse : « Évaluation de l’impact des pesticides appliqués dans les zones de production de légumes en zone saharienne : le cas du Burkina Faso », soutenue en fin décembre 2017 après 3 ans de rechercher dans la zone et autour du barrage de Noumbila.
L’ex candidat à la thèse a mené ses recherches auprès de 540 maraîchers burkinabés actifs sur quatre sites différents du centre du pays en disséquant leur pratique agricole. « Lors de la saison des pluies, nous avons détecté chaque année dans le lac de Loumbila une augmentation des concentrations de pesticides dont certains sont interdits au sens de la Convention de Stockholm, ratifiée par le Burkina Faso.» a écrit le chercheur. Nommés POPs (persistent organic pollutants), ces pesticides qu’il a identifiés sont considérés comme « une grave menace pour la santé et l’environnement », car leur nuisance est durable et persistante. L’étude s’est également intéressée à la qualité de l’eau issue des puits et des forages. Il ressort des résultats que 30% des puits traditionnels creusés dans les champs se sont avérée impropres à la consommation car contaminés aux pesticides. Si la pollution à outrance des ressources en pleine capitale Ouagadougou bat son plein, que dire de celles à l’intérieur du pays ?

Une addiction à l’échelle nationale et une pollution tous azimuts
Le Burkina Faso vit à 90% de l’agriculture. Le manque de main d’œuvre et la volonté d’un bon rendement sont entre autres les principales raisons de l’usage des pesticides. Les types généralement utilisés par les agriculteurs sont les acaricides utilisés pour tuer les acariens (araignées); les herbicides utilisés pour détruire les mauvaises herbes; les insecticides utilisés contre les insectes, les fongicides destinés à détruire les champignons microscopiques qui attaquent les plantes, les animaux ou les humains.
Le recours aux pesticides inquiète les experts. Moussa Koné, président de la chambre nationale d’agriculture affirme au cours d’un débat sur la question que « l’utilisation des pesticides est systématique » chez les paysans au Burkina Faso. Le représentant de la Confédération paysanne du Faso (CPF), Marc Gansonré, renchérit que la majorité écrasante des paysans utilisent les pesticides sans formation préalable. Certains n’hésite pas à « gouter » de la langue les pesticides. S’ils piquent, la conclusion de son efficacité est tirée. Malheureusement, dans cet usage massif, le docteur Fousséni Traore, entomologiste à l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) affirme que « moins 0,3% des pesticides atteint sa cible et les 99,07 % vont ailleurs, dans l’environnement notamment dans le sol, l’eau ». L’autre manche du problème est que nombreux sont les pesticides non homologués qu’on retrouve abondamment sur le marché. Le docteur Traore précise que ces pesticides que l’on retrouve dans la nature notamment dans les cours d’eau au Burkina sont des « organo-chloré, qui sont très toxiques » et « hautement interdits au Burkina ». Leur « persistance » produit d’énormes dégâts « inimaginables » pour la biodiversité et les hommes. C’est donc essentiellement selon les personnes ressources, des pesticides non homologués qui sont utilisés. L’entomologiste signale qu’en cas de problème de santé par exemple, la prise est « très difficile car les molécules ne sont pas connues ». Souventes fois, on assiste à des détournements d’utilisation de ces pesticides. Ceux par exemple destinés au coton sont utilisés dans le maraîchage.
Pour Moustapha Congo, « au regard de l’ampleur de l’usage des pesticides sur le plan national on peut affirmer que les ressources en eau courent un grand danger ». Il ajoute que l’usage abusif de ces pesticides « est une grande préoccupation pour les acteurs des ressources en eau au regard des risques de pollution… La grande majorité n’est pas homologué. Ce sont des produits qui ont souvent un niveau de toxicité assez élevé, donc nuisibles aux ressources en eau… Même avec les pesticides homologués, il y a des précautions et règles à observer pour minimiser leurs impacts alors que ce n’est pas ce qui se fait ».

L’épandage des pesticides est très accentué dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins qui sont des zones hautement agricoles. Les marchés de ces zones ont la particularité d’être envahi par les pesticides. Dans pratiquement tous les recoins on trouve d’impressionnant étalages où sont exclusivement vendus des pesticides avec des noms assez expressifs pour attirer comme « La Machette ». Ces régions ont également la particularité d’abriter l’essentielle des ressources en eau du Burkina.
Les ressources en eau nationale sous l’emprise des pesticides ?
Selon un rapport d’étude de chercheurs intitulé « Agriculture, Eau, Climat et Migration en terre Demi-arides au Burkina Faso » le barrage Ziga qui désert une en grande partie Ouagadougou en eau potable est en contact des pesticides. Ce qui rend « trop élevé le coût de traitement pour l’ONEA », précise l’étude. Outre, le fleuve Mouhoun, le plus grand cours d’eau du Burkina en fait les frais. En rappel, ce fleuve fait environ 1000 km sur le territoire national. Il alimente permanemment une kyrielle de cours d’eau secondaires comme le Kou. Ce fleuve traverse la région du Mouhoun, des Hauts bassins et des Cascades pour continuer en Côte d’Ivoire et au Ghana. Des témoignages et même des cas de mort massive de poisson provoquée par les pesticides sont souventes fois rapportés. En fin 2020, Armel Soumbougma, chef de service ressource en eau de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, reconnaissait que la biodiversité était fortement menacée dans cette ressource à cause des pesticides. Les poissons se raréfient dans ce cours d’eau à cause des produits. Ceux qui y sont, subissent ces produits et deviennent extrêmement dangereux pour l’homme lorsqu’il les consomme. Alors que beaucoup de nos poissons d’eau douce proviennent de cette partie du Burkina. « Lorsque les pesticides intègrent un organisme vivant, ils deviennent plus dangereux et nuisibles » nous révèle le chef de service. Outre, l’ONEA utilise l’eau de ce fleuve pour desservir des grandes villes comme Dédougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, etc en eau potable. Et le danger avec les pesticides comme le dit M. Congo, « Un polluant qui s’introduit dans un cours d’eau ne se limite pas à rester là où il tombé. Il va aussi loin possible avec l’eau qui l’entraine à des kilomètres ».
Un important barrage comme le barrage de Samendeni dans les Hauts-bassins n’est pas épargné par le fléau. En effet, il ressort du « Rapport de mission Contrôle du respect de la bande de servitude du Barrage de Samendeni Période concernée : 29 au 31 Mai 2019 » qu’en : « moins de deux ans après la mise en eau du barrage, l’occupation de bande de servitude voire la cuvette du plan d’eau en certains endroits pour la production des cultures maraichères par les populations ayant été indemnisées est une réalité dévastatrice de la retenue. Aussi l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques dans la bande de servitude va détériorer rapidement la qualité des eaux. Si la tendance n’est pas inversée, il est fort probable qu’on assiste à un envasement rapide du barrage et au phénomène d’eutrophisation qui détruira toute vie aquatique. Ainsi la suite du programme sera compromise et tout l’investissement sera réduit à néant pour des intérêts égoïstes de certains individus. » Rappelons que ce barrage est construit sur le fleuve Mouhoun et est le troisième barrage le plus important du Burkina Faso après ceux de Bagré et de Kompienga. Il s’étend sur plus de 10 000 ha de terre, avec une capacité de 1 milliard 50 millions de mètres cubes d’eau.

Selon la deuxième monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso, environ 350 espèces de plantes, 12 espèces de mammifères sauvages, 19 espèces d’oiseaux, 24 espèces de reptiles et 48 espèces de poissons sont menacées d’extinction.
Perturbateurs endocriniens et graves problèmes de santé publique
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit un perturbateur endocrinien comme une « substance ou mélange exogène modifiant la (les) fonction(s) du système endocrinien et provoquant ainsi des effets sanitaires nocifs dans un organisme intact, sa descendance, ou ses sous-populations ». Nombre des perturbateurs endocriniens proviennent des pesticides.
La thèse du docteur Edouard Lehmann révèle sur les populations autour du barrage de Moumbila que « Les concentrations détectées dans les cheveux sont préoccupantes, car plus élevées que dans d’autres régions du monde et indiquent une exposition à des substances classées perturbateurs endocriniens et cancérogènes ». Il est également écrit que la « population, en particulier les enfants, est exposée à des concentrations de perturbateurs endocriniens et à des cancérogènes potentiellement dangereuses ».
Les perturbateurs endocriniens sont suspectés d’être à base de nombreuses pathologies chroniques ou développementales : troubles hormonaux et leurs conséquences (infertilité, puberté précoce, obésité, maladie thyroïdienne…), mais aussi malformations congénitales, cancers hormono-dépendants, et même troubles de l’immunité. Des experts indiquent que les effets sur la santé humaine qui « pourraient être liés à une exposition à ces produits incluent l’apparition de cancers du sein, de la prostate et des testicules, une baisse de la quantité et de la qualité du sperme, des troubles comportementaux ou mentaux et des perturbations des fonctions immunitaire et thyroïdienne chez l’enfant ».
De plus en plus, au Burkina, on assiste à un taux élevé d’infertilité chez les hommes et les femmes. Les centres de santé reçoivent de plus en plus d’enfants souffrant de cancer. Un article publié le 26 février 2019 par L’Observateur Paalga sous le titre « MALADIES RARES : LES CANCERS DE L’ENFANT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS AU BURKINA » met un lien entre l’explosion du cancer chez les enfants et les pesticides. Répondant à une question sur la cause du cancer des enfants, le

a cité des « facteurs environnementaux » dont « les pesticides ». D’autres maladies comme l’insuffisance rénale bat également son plein. Il n’est pas rare d’entendre de nos jours des agents de santé parler de l’explosion des troubles menstruelles chez les femmes au Faso. Faut-il lier toutes ces pathologies cela aux seuls pesticides ? En tout cas la question mérite d’être posée…L’un des pesticides interdits ailleurs mais qui est énormément utilisé au Burkina est l’atrazine. Ce pesticide est signalé comme un concentré de perturbateur endocrinien… Un rapport de de l’ONG Générations futures, publié en juin 2020 montre que des traces de « pesticides retrouvés dans l’eau du robinet sont majoritairement des perturbateurs endocriniens suspectés ». Les données « montrent clairement que des pesticides sont fréquemment retrouvés dans l’eau du robinet en France (dans 35,6% des analyses les recherchant) et que parmi les résidus retrouvés, les molécules CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) et/ou suspectées PE représentent plus des trois quarts des quantifications individuelles de pesticides », indique le rapport. L’herbicide atrazine interdite depuis une dizaine d’année y est pour quelque chose. Au Burkina, un haut cadre de l’ONEA nous confiait que les « installations » de son institution ne permettaient d’éliminer tous les polluants qui se retrouvent dans les ressources en eau du pays.
Dans tous les cas, le « Quatrième rapport sur l’état de l’environnement au Burkina faso sp / cndd » – publié décembre 2017 souligne que « les pesticides et herbicides génèrent… des maladies chroniques (cancers,) et malformations, par le biais de leur accumulation le long de la chaîne alimentaire ». Ce qui aura comme effet domino, un impact négatif au plan économique en ce sens que la productivité du secteur agricole prendra un coût à cause des « pertes de capacité de travail » des paysans tombés malades à cause des pesticides. Les coûts de traitement et d’hospitalisation mobilisent beaucoup d’argent et la famille et des proches qui devront à leur abandonner leur activité pour au chevet du malade.
Plus de 10 milliards de pertes par an
Une main d’œuvre malade dans un secteur aussi stratégique qu’est l’agriculture ne peut qu’entrainer une récession économique d’envergure nationale. C’est d’ailleurs ce que prouve le « Quatrième rapport sur l’état de l’environnement au Burkina faso sp / cndd ci-dessus cité en indexant le « coût de l’inaction » gouvernementale. « L’utilisation actuelle de produits chimiques dans ce secteur (agriculture ndlr) engendre des pertes pour l’économie et la population de 10,9 milliards de FCFA par an (soit 24,2 millions de dollars USD) ».
L’eau étant au cœur de la vie des êtres vivants, il devient impérieux d’agir pour changer la donne. Sinon si l’on ne prend garde, les supplices que le terrorisme afflige au Burkina risque d’être un épiphénomène face aux conséquences apocalyptiques de la pollution des ressources en eau. Le coût de l’inaction risque d’être irréparable. Pourtant des études notamment du Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement (GRAAD), intitulée « Coût des mauvaises pratiques dans l’usage des produits chimiques dans le secteur agricole » montrent qu’en investissant « 1 F. CFA dans des politiques ou actions de remédiation, l’Etat gagne en moyenne 2 F. CFA, soit de 2 fois les sommes dépensées ou investies. Ce chiffre est de 2,21 pour les catégories économiques (santé et qualité de vie, capital naturel et inefficiences dans les ressources) et de 1,78 FCFA par franc investi pour les domaines environnementaux (eau, air, bruit, sols et forêts, déchets, énergie et matière) ». Sur la pratique agricole, le GRAAD révèle que « 1 FCFA investi dans les modes de production durables rapporte en moyenne 11,31 FCFA ».
Hamidou TRAORE
ENCADRE
Parole digne d’intérêt de Moustapha Congo
« Si les sources d’approvisionnement en eau sont polluées, notamment les eaux de surface et les eaux souterraines, il y a risque de santé publique car les polluants sont toxiques. La pollution réduit forcement la quantité des ressources utilisables disponibles parce que l’eau polluée ne saurait être utilisée sans traitement spécifique. Il y a des cas où la pollution est irréversible donc cette eau reste inutilisable. Dans le cas où la pollution peut être traitée, il est à noter qu’il faut utiliser beaucoup plus de moyens techniques et financiers pour ce traitement, ce qui peut conduire à l’augmentation du coût de la facturation de la consommation et donc difficile à supporter pour les populations ».
Cette cadence de contamination des ressources en eau du Burkina, fonde à être pessimiste quant à la possibilité du Burkina Faso d’atteindre le point 6 des Objectifs du Développement Durable (ODD) en rapport avec l’accès universel à une eau salubre.